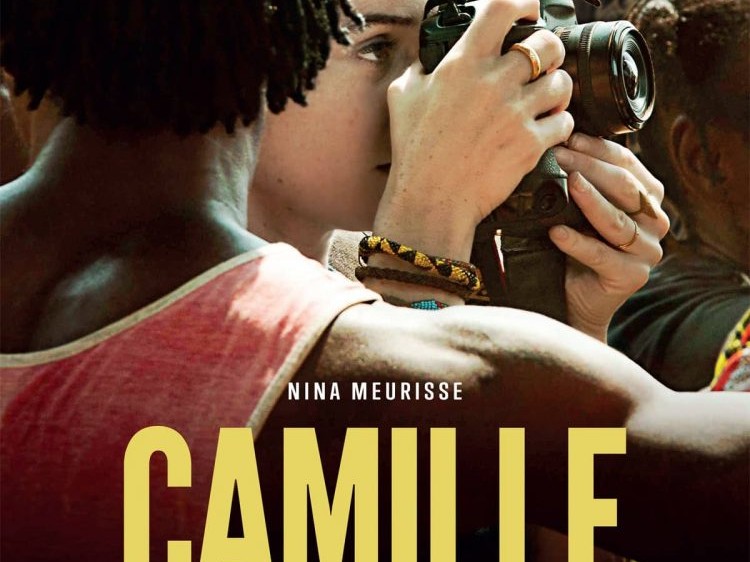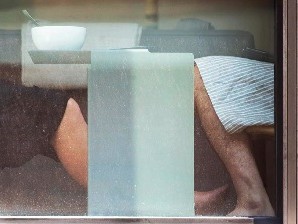La photographie aérienne est une discipline fascinante qui offre une perspective unique sur notre planète. On découvre alors des paysages à couper le souffle, qu’il est exceptionnel d’observer sous cet angle. Après des années de travail dans le domaine scientifique, Andro Loria a su allier son amour pour la nature et ses compétences techniques pour capturer des paysages d’une beauté rare depuis les airs. La photographie aérienne est aujourd’hui sa spécialité, même s’il a auparavant expérimenté de nombreux pans de la photographie. Son approche mêle rigueur technique et sensibilité artistique, offrant des vues spectaculaires qui révèlent la grandeur de la nature sous un angle inédit.
Avec ces images, Andro Loria partage également son lien avec la nature et aspire à le transmettre, ainsi que l’envie de la préserver et la protéger. Selon lui, « Si des personnes commencent à aimer la nature davantage, il y a une chance qu’elles la protègent davantage, car nous avons tendance à prendre soin de ce que nous aimons. »
Découvrez notre interview exclusive du photographe Andro Loria : immersion dans la pratique de la photographie aérienne.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers la photographie ?
C’est une longue histoire… Je pense qu’il serait préférable de dire que la photographie (telle que je la pratique aujourd’hui) m’a trouvé et est finalement entrée dans ma vie au bon moment, après quelques tentatives moins réussies 🙂
J’ai grandi à une époque où la photographie était analogique. Je me souviens d’avoir eu un petit appareil photo à objectif fixe, que j’utilisais avec une pellicule noir et blanc pour photographier mes amis, ce qui est à peu près la même chose que ce que font les gens avec leur smartphone aujourd’hui.
C’était amusant de photographier, mais encore plus de développer les films, de les projeter sur du papier photo et de fixer les tirages. Voir une image apparaître à partir de « rien » a toujours eu un côté un peu « magique ». Je n’ai pas beaucoup photographié pendant mes études, même si j’emportais un petit appareil photo avec quelques rouleaux de pellicule lors de mes excursions en kayak sur de longues distances. Le fait d’être limité à l’utilisation de pellicules m’empêchait de m’engager davantage dans la photographie.
Laboratoires scientifiques et biologie structurelle : une porte d’entrée vers la photographie ?
À l’époque, mes activités de photographie et de traitement d’images se limitaient à l’environnement des laboratoires scientifiques : prise de photos de gels d’ADN, exposition/développement de films radiographiques pour lire des séquences d’ADN, etc.
Je suis ensuite passé au domaine de la biologie structurelle. Et j’ai fait beaucoup d’analyses en 3D de machines protéiques qui protègent notre intégrité génomique. Je suppose que cela m’a aidé à développer une sorte de vision 3D, c’est-à-dire comment voir un objet sous différents angles et choisir quel angle serait le meilleur pour le représenter.
J’avais déjà une certaine formation dans ce domaine grâce à une formation au dessin technique pendant mes études, à une formation à la topographie et à la navigation lors de mes voyages, mais mon travail scientifique m’a permis de passer au niveau supérieur. J’ai également beaucoup appris sur l’imagerie numérique et sur les capacités des capteurs numériques haut de gamme.
À un moment donné de ma vie, il m’est apparu clairement que j’aimerais avoir un peu plus que mes souvenirs visuels des endroits que je visite. Alors il y a environ 12 ans, je me suis procuré quelques appareils photo sans miroir, dont je suis rapidement tombé amoureux. De plus, mes travaux scientifiques entrant dans une période où l’expérimentation est moins présente, la photographie est devenue mon nouveau débouché créatif supplémentaire, voire primordial. Un nouveau champ d’exploration, d’observation et de réflexion.
Quel est votre lien avec la nature et qu'est-ce qui vous a donné envie de la photographier ?
Eh bien, nous sommes tous liés à la nature d’une manière ou d’une autre. Nous en faisons partie. Je suppose que c’est le biologiste en moi qui parle. 🙂
Quand j’étais enfant, j’ai grandi dans une petite ville située sur la rive vallonnée d’une rivière avec de superbes paysages tout autour. Il y avait un parc national de l’autre côté de la rivière et les animaux sauvages passaient souvent de notre côté. Ainsi, certains matins d’hiver, il était amusant de voir qui était venu nous rendre visite en lisant les traces des animaux dans la neige.
Je rentrais souvent à la maison après l’école pour faire une promenade en forêt au printemps et à l’automne, ou pour faire du ski dans les bois voisins avec le chien de la famille en hiver. Et bien sûr pour passer des journées entières dans les bois en été, avec ma famille ou mes amis. Je suppose qu’après des décennies de voyages dans les régions subarctiques et dans diverses montagnes, toujours en camping sauvage, j’ai un lien très fort avec la nature. On apprend à vivre dans la nature, à la respecter et à l’aimer.
Voir des panoramas incroyables depuis les montagnes ou faire du rafting ou du kayak sur des rivières d’eau vive procure un sentiment d’émerveillement d’une part, mais aussi le sentiment d’en faire partie, de bouger avec elle, de la respirer, de la ressentir de multiples façons. En outre, il est difficile de ne pas voir les changements que subit notre planète, de vastes zones se transformant radicalement au cours de notre vie en raison du changement climatique et de l’activité humaine.
Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose qui m’ait « poussé » à photographier la nature.
J’ai photographié beaucoup de choses quand j’ai commencé, l’architecture, des portraits en noir et blanc, quelques années de photographie de rue, même les mariages de mes amis ! Mais peu à peu, on en est arrivé au point où, comme pour toute chose dans la vie, on commence à faire plus (ou à essayer de faire plus) de ce qu’on préfère. Et pour moi, c’était la photographie de nature, et plus particulièrement la photographie de paysages aériens.
Ce qui fait que depuis 7 ou 8 ans, je ne cesse de faire de la photographie aérienne. Photographier la nature m’éloigne des gens (c’est-à-dire de trop de gens). Voler me procure une sorte de « méditation », si l’on veut. Bien que la surcharge visuelle que l’on reçoit lorsqu’on photographie depuis un avion ou un hélicoptère en mouvement puisse difficilement être décrite comme un état zen, avec un tapis roulant sans fin d’images kaléidoscopiques qui vous arrivent de tous les côtés.
Voler offre la possibilité de voir des vues incroyables venues d’un autre monde, d’avoir une perspective unique, de voir des choses et des endroits d’une manière différente et inédite, la liberté, la paix et de rencontrer des personnes formidables partageant les mêmes idées, aussi bien des pilotes que des photographes.
À la fin de la journée, je suppose que nous (en tant qu’êtres humains) essayons de protéger et de prendre soin de ce que nous aimons. Donc, même si les images que je crée sont principalement destinées à mettre en valeur la beauté de ces vues, elles représentent aussi une manière de les protéger et de les préserver telles qu’elles sont, sous forme de documentaire, dans notre monde en constante évolution, et en espérant que certaines personnes puissent se rapprocher de ces lieux et nouer des liens avec eux.
Si elles commencent à aimer la nature davantage, il y a une chance qu’elles la protègent davantage, car nous avons tendance à prendre soin de ce que nous aimons aussi.
Dans votre interview pour Fujifilm, vous expliquez que vous établissez un plan de vol précis, soit en fonction des lieux que vous avez déjà visités et repérés -par exemple lors de randonnées- soit lorsqu'il s'agit de lieux que vous ne connaissez pas, grâce à des images satellites. Comment choisissez-vous ces lieux ?
Oui, c’est vrai, il faut beaucoup planifier, même si ces plans ne tiennent pas toujours. 🙂
Tout commence par une idée de l’endroit où j’aimerais aller. Ensuite, je consulte les images et les descriptions de la région faites par d’autres personnes (s’il y en a) pour avoir une meilleure idée des changements et des schémas saisonniers.
La plupart de mes recherches sont faites avec Google-Earth, en identifiant d’abord les zones d’intérêt et les points spécifiques qui pourraient être intéressants. Cela permet d’esquisser une trajectoire de vol potentielle, pour en voir autant que possible et à la meilleure lumière et/ou niveau de marée. Ce qui peut ensuite être utilisé pour estimer la longueur du vol et donc le carburant/le temps nécessaire pour le faire de manière à inclure quelques boucles de 360 degrés (tours) au-dessus de chaque point d’intérêt. Quatre heures est un temps de vol typique. Cinq à six heures, voire sept heures, sont possibles avec une pause et un ravitaillement en carburant. Tout cela est ensuite communiqué au pilote pour qu’il l’évalue et le modifie en fonction de sa connaissance des vents, des schémas météorologiques et des prévisions.
Nous avons toujours deux ou trois options de vol différentes à choisir en fonction de la météo. L’une d’entre elles doit être choisie la veille ou tôt le jour du vol en fonction de la météo – vents, pluie, heure des marées, couverture nuageuse (couche de base des nuages, etc.). J’ai mentionné que le pilote aura le dernier mot en ce qui concerne le lieu et la manière de procéder, quel que soit le plan choisi. Ce qui signifie que le pilote aura le dernier mot en ce qui concerne la décision de voler ou non dans une zone le jour du vol.
Il y a des zones que nous avons dû survoler, ou plutôt essayer de survoler plus d’une fois, deux ou trois fois dans certains cas. Même avec des prévisions parfaites, vous pouvez découvrir que le point d’intérêt de votre destination est complètement couvert de nuages. Ou que le niveau de base des nuages est trop bas pour obtenir une bonne prise de vue de haut en bas. Ce qui vous amène à changer de plan et de zone.
La photographie aérienne est un travail d’équipe étroit avec le pilote.
Vous vous mettez d’accord sur les mots et les gestes de communication à utiliser. Vous discutez avant le vol de ce qui vous attend lorsque vous survolez un point d’intérêt, etc. Le pilote prend la décision finale de savoir si l’on vole ou non, si l’on entre dans la zone d’intérêt. Le choix des lieux se fait en fonction de ce que je vois sur les images satellites, de ce que je pense voir d’après mon expérience après avoir volé/randonné dans la région et réfléchi à la manière de la capturer d’une manière différente. Par exemple la poudreuse de neige fraîche, la poussière battue par la pluie fraîche qui fait ressortir les couleurs plus vives des rochers… Mais je n’opte jamais pour une photo spécifique que j’ai en tête. C’est toujours un livre ouvert ; je n’aime pas trop y réfléchir.
Comme nous le disons en science, nous planifions les expériences, mais pas les résultats. C’est quelque chose qu’il faut voir et découvrir une fois sur place. Les endroits que je choisis sont ceux qui présentent des motifs agréables et des caractéristiques paysagères qui permettent un rendu en 3D avec des ombres et des lumières. J’essaie actuellement de revisiter certains endroits en Islande à différentes saisons, pour les voir sous une lumière et des couleurs différentes.
Lorsque je reviens d’un vol et que je découvre de nouveaux endroits, j’essaie toujours d’en apprendre davantage sur la géologie et la nature de la région, d’essayer de mieux les comprendre, d’apprendre pourquoi les rivières ou les rochers ont des couleurs spécifiques, quelles sont les variations de motifs dans la région dues à l’activité géothermique, aux changements saisonniers, etc.
Qu'est-ce qui attire votre attention et vous fait penser que c'est l'endroit idéal pour prendre ces photos ?
C’est une très bonne question, et la réponse est : c’est très changeant… Cela dépend beaucoup du moment, de mon humeur, de la lumière, etc. Notre façon de voir les choses (et la mienne) évolue avec le temps et l’expérience. Il m’est arrivé si souvent, alors que je volais dans la région pour photographier des sites ou des vues préétablies, de faire des photos totalement inattendues et de les apprécier davantage. Et encore plus sur le chemin vers ces zones.
La photographie aérienne est très réactive, vous ne pouvez pas avoir une « vision en tunnel » et rechercher un cliché spécifique dans votre tête. De cette manière, vous raterez beaucoup de prises de vue, y compris les meilleures possibles. Il est intéressant de noter que je trouve que la photographie aérienne ressemble un peu à la photographie de rue en termes de réaction à ce que l’on voit. Vous ne planifiez pas une image à l’avance. Vous volez, vous explorez, vous réfléchissez et vous réagissez avec votre appareil photo.
Votre appareil photo est toujours prêt, à côté de votre œil. Vous anticipez la situation, votre esprit apprend à « prévoir ». Qu’il s’agisse d’une combinaison de lumières, de couleurs et de silhouettes dans une scène de rue, ou de lumières et de motifs dans une vue aérienne, de haut en bas ou de biais, en sentant le cadre avec la géométrie élémentaire apparemment chaotique, mais naturellement équilibrée de la nature. Souvent, cet élément supplémentaire est une volée d’oiseaux qui entre soudainement dans le cadre pour le rendre moins organisé et plus naturel, en y apportant un peu de vie. Bien qu’il soit un peu abstrait pour la plupart des gens, car nous ne regardons généralement pas d’oiseaux en vol vus d’en haut. En général, ces meilleures images restent dans votre esprit à partir du moment où vous les voyez et appuyez sur l’obturateur. Lorsque tout s’emboîte et que vous le sentez.
Les paysages que vous photographiez depuis le ciel apparaissent comme abstraits. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rendu ?
Il est vrai que les images prises à partir d’un avion, en particulier les prises de vue de haut en bas, sont très différentes, car elles perdent toute référence à l’échelle, aux lignes d’horizon et au sens de la perspective. Cependant, le terme d’abstraction n’est probablement pas correct, car ces images existent, mais nous ne voyons pas ces vues et ces paysages. Ils sont parfaitement normaux pour les oiseaux, reflètent la réalité existante et ne semblent « abstraits » que pour nous, les humains. Car ils ne reflètent pas notre façon typique de voir les choses dans une perspective latérale.
Il en va de même pour les images scientifiques, qui sont si éloignées de notre façon habituelle de voir les choses, et pourtant la beauté des mondes macro et microscopiques existe bel et bien. Ce que j’aime dans cette façon inhabituelle de voir et d’imager, c’est qu’elle vous permet de voir la beauté invisible du monde, de la capturer pour que tout le monde puisse la voir et de vous sentir comme un explorateur d’un monde différent avec des images étonnantes qui changent constamment devant vos yeux et votre appareil photo. Et tout cela en plus du vol lui-même, qui est déjà extraordinaire.
D'un point de vue technique, y a-t-il beaucoup de post-production dans vos images ?
J’essaie de ne pas passer beaucoup de temps à éditer les images. Je passe le plus clair de mon temps à décider quelle(s) image(s) je considère comme la meilleure avant de les éditer. Un grand nombre d’images sont le résultat de quelques tours de piste au-dessus d’un sujet. Il y a donc inévitablement des répétitions, ou du moins des images qui sont similaires les unes aux autres. Certaines images pourraient être affectées par une forte réflexion de l’eau ou de la glace, donc à moins que je ne les trouve intéressantes, elles sont rejetées.
Sur les 2000 à 3000 images que je rapporte d’un voyage, avec environ 1 000 images réalisées en un vol, je m’efforce de conserver environ 10 % des plus fortes, ce qui est bien supérieur à ce qui peut être fait sur le terrain dans ce laps de temps. Je dirais qu’il faut quelques minutes de post-traitement par image, juste pour ajuster la balance des blancs – je prends toujours des photos sur carte couleur et j’incorpore délibérément les ailes de l’avion (qui sont généralement blanches) dans certaines images, afin d’avoir une référence pour les conditions de luminosité avec lesquelles je travaille.
Je sous-expose généralement d’un ou deux diaphragmes en fonction de la lumière. C’est facile avec un appareil photo numérique, car je peux suivre l’histogramme en direct dans mon viseur. Il peut y avoir un léger dégradé dans le haut du cadre pour compenser le ciel (s’il y en a un) et/ou une partie du cadre légèrement plus lumineuse en raison de la différence de réflexion de la lumière (perspective aérienne), parfois un léger recadrage/rotation – j’essaie généralement de ne pas retirer plus de 5 à 10 % du cadre. Dans la plupart des cas, cela se produit lorsqu’une partie de l’aile ou de la roue entre dans le cadre en raison de turbulences ou d’un mouvement inattendu de l’avion et/ou de l’appareil photo.
Je n’ai pas besoin de modifier la netteté – les objectifs que j’utilise sont incroyables, mais je l’ajusterais pour l’impression en fonction de la taille de sortie de l’impression. Personnellement, je préfère le format 4:3, c’est ainsi que je vois les choses et cela fonctionne très bien pour les prises de vue aériennes, donc j’utilise rarement, voire jamais, d’autres types de cadres. Je me tiens à l’écart des objectifs grand angle, car je trouve que tout ce qui est plus large qu’une longueur focale de 40 à 50 mm est trop large. Je préfère prendre des photos avec un téléobjectif court, entre 60 et 70 mm, afin de ne pas avoir de problèmes de distorsion du paysage qui devraient être corrigés. Lorsque je photographie des vues de haut en bas, je prends des photos à 70-90 mm. Là encore, il n’est pas nécessaire de corriger les distorsions.
Je prépare les fichiers pour l’internet, mais je passe plus de temps à préparer certains fichiers pour l’impression avec le profilage du papier, etc. J’utilise les logiciels Adobe Lightroom et Capture One pour le post-traitement.
Y a-t-il un lieu que vous avez photographié qui vous a particulièrement fasciné ou marqué ? Si oui, pourquoi ?
J’ai en tête une longue liste d’endroits qui m’ont plus étonné que d’autres. Il s’agit notamment du glacier Múlajökull et de ses lacs de kettle glaciaire ; des kettles glaciaires du Mirdalsjökull ; des motifs de mousse presque luminescents (techniquement, il s’agit de lichen) sur les hauts plateaux islandais ; des motifs étonnants des rivières glaciaires tressées le long de la côte sud, en particulier au sud de Skaftafell ; de la zone volcanique de Grímsvötn sur la calotte glaciaire de Vatnajökull et des lacs alcalins (comme Magadi) dans le sud du Kenya.
Tous ces endroits avaient quelque chose qui dépassait mes attentes, que ce soit les couleurs vives des lacs glaciaires, l’énormité et l’échelle pure de la merveille du paysage à Múlajökull et Grímsvötn ou les couleurs et la lumière intenses au Kenya.
En général, l’Islande est un endroit extraordinaire pour voler et photographier, car sa taille compacte vous permet de voir tous les types de paysages possibles et imaginables en l’espace de quelques heures. C’est comme un continent en miniature, avec des possibilités infinies de trouver de nouvelles vues et de nouvelles façons de les photographier.
J’espère pouvoir voler et photographier au Groenland et en Amérique du Sud, de sorte que la liste des endroits étonnants continuera de s’allonger et qu’il y aura bien sûr d’autres endroits à explorer en Afrique, en Australie et en Amérique du Nord.
À LIRE AUSSI
- Les plus beaux paysages du monde photographiés au drone par Cédric Houmadi
- Ocean Pools, les photos aériennes de Nicole Larkin
- Les paysages vus du ciel du photographe Zack Seckler
- Découvrez les magnifiques photos aériennes de Michael B. Rasmussen !
- Interview exclusive de notre parrain, le photographe Yann Arthus-Bertrand